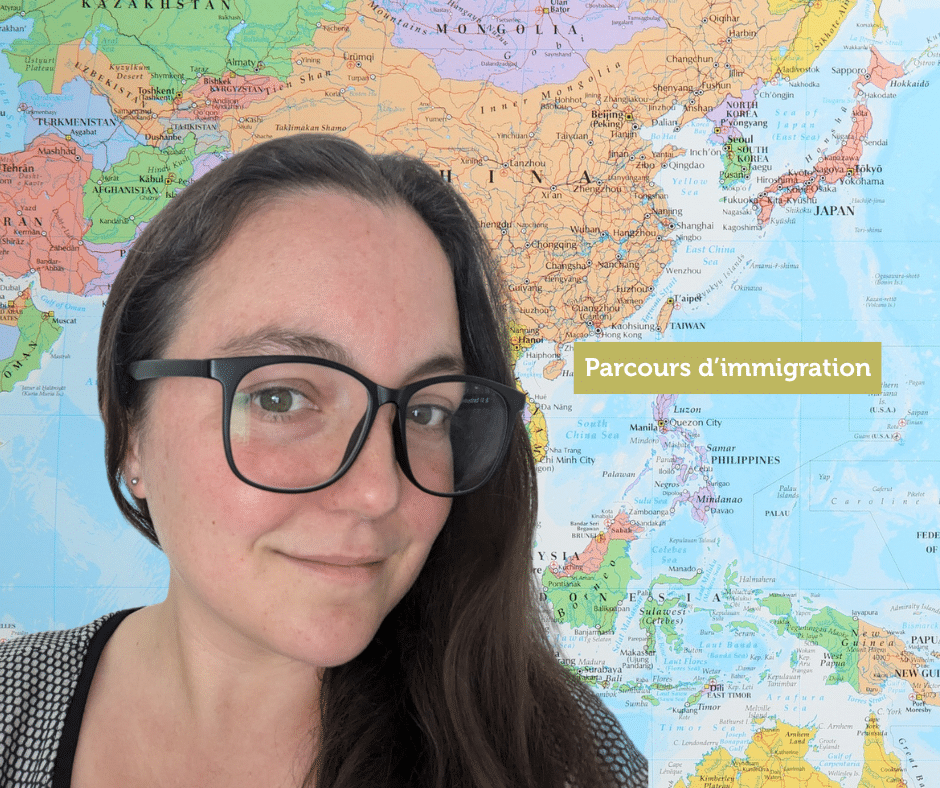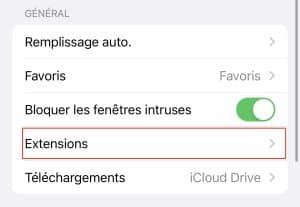Chaque mois, notre nouvelle collaboratrice Isabelle Cossette vous proposera des récits de personnes venues d’ailleurs établies en Mauricie. Ce mois-ci, elle nous présente le parcours exceptionnel qui a mené la famille de Nikolaï Vokuev et Elena Soloveva de la Russie de Poutine à Trois-Rivières.
J’ai rencontré Nikolaï Vokuev dans un séminaire doctoral à l’UQTR en septembre 2021. Nous étions collègues, et j’ai rapidement compris que cet homme, qui s’intéresse aux aspects politiques du journalisme culturel en Russie, était l’une des personnes les plus érudites que j’aie jamais rencontrées. J’avais alors un petit logement à louer, et c’est là qu’est venu s’établir Nikolaï. Et c’est également là que s’est retrouvée toute sa famille, environ neuf mois plus tard. Mais quels mois !
Lors de l’entrevue, tout le clan est là : les parents ainsi qu’Andreï, qui a maintenant 10 ans, et Léra, qui en a 20. C’est extraordinaire de les revoir après trois ans : si Nikolaï s’exprimait dans un français impeccable avant d’arriver au Québec, sa femme et ses enfants n’en parlaient pas un mot. Mais toute l’entrevue se déroule en français, une langue apprise avec la détermination de gens qui savent qu’ils sont là pour rester.
Journalistes et protestataires
Elena et Nikolaï se sont rencontré-es dans le cadre de leur travail de journalistes. Si Nikolaï se tourne par la suite vers une carrière d’enseignant et de chercheur universitaire, Elena, elle, se spécialise dans les questions environnementales et devient rédactrice en chef d’un média indépendant opposé au gouvernement russe. De 2018 à 2020, son travail la mène à s’insurger contre l’ouverture d’une méga-décharge dangereuse qui aurait menacé l’équilibre écologique dans sa région. « Elle est devenue une experte sur le sujet pour les médias indépendants russes, me lance fièrement Nikolaï. Notre appartement est devenu un vrai hub pour les militants, les chercheurs et les journalistes d’autres pays. »
Après deux années de militantisme, victoire : la décharge ne sera pas créée. Mais trop tard : à l’apogée des protestations, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) commence à s’intéresser au couple.
Le FSB est le successeur du KGB. La famille vit à Syktyvkar, une ville de 240 000 habitant-es. « Tout le monde se connaît », explique Nikolaï. Il n’est donc pas difficile de voir les signes de l’intérêt du Service à leur égard, mais cette réalité devient inconfortablement concrète le jour où Nikolaï reçoit l’appel d’un agent qui propose de les rencontrer pour « discuter de leurs relations avec des chercheurs étrangers ». La rencontre n’aura jamais lieu, mais le couple sait désormais qu’il est sur de bien mauvais radars : « Après tous ces signaux, on a compris que la situation devenait de plus en plus dangereuse pour nous, on a regardé les options pour partir », souligne Nikolaï. Il décide alors qu’il poursuivra ses études doctorales à l’étranger et fera venir sa famille par la suite.
En tant que doctorant, Nikolaï cherche alors un établissement d’enseignement qui lui permettrait de mener des recherches dans son domaine, le journalisme culturel. Une réponse positive du Département de lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières en la matière scelle, en somme, le sort de la famille.
C’est en juin 2021 que Nikolaï arrive seul à Trois-Rivières avec son statut d’étudiant international. Malheureusement, la même année, un désastre ébranle la famille.

Léra, Elena, Andreï et Nikolaï. Photo : Isabelle Cossette / © La Gazette de la Mauricie et des environs
Elena, agente de l’étranger
La visibilité d’Elena avec le dossier de la décharge lui vaut un triste prix : « J’ai été jetée sur la liste des agents de l’étranger. » Avec ce statut, il lui est désormais interdit de travailler légalement, entre autres choses. « Si quelqu’un te donne du travail, c’est un danger pour lui », m’explique-t-elle. Nikolaï étant au Canada, seule avec leurs enfants, elle perd sa source de revenus, et les conséquences financières sont catastrophiques.
Début 2022, la guerre en Ukraine éclate. Les frontières se ferment, les finances de la famille ne s’améliorent pas, la situation devient « pire et pire et pire et pire », me dit Elena. La décision de quitter la Russie est prise.
En mars, Elena et les enfants se rendent à l’aéroport, direction la Turquie. L’objectif est alors simplement de sortir du pays. À la douane, on l’interroge avec insistance, elle qui est née en Ukraine et qui a souvent visité ce pays. Elle justifie l’absence de billet de retour par les fréquentes annulations de vols qui marquent le début du conflit. « Finalement, un monsieur est venu, il a pris nos documents et a disparu », raconte-t-elle avec émotion. « Quel idiot ! » s’exclame alors Andreï.
À l’aéroport, Elena, terrorisée, fait semblant que la situation est normale pour ne pas terrifier les enfants. Une interminable heure plus tard, enfin, on leur permet de partir.
Une course contre la montre
Nous sommes alors le 14 mars 2022. Leur visa leur permet de rester 60 jours en Turquie. Elena a donc 60 jours pour trouver leur chemin vers le Canada.
Près d’un mois plus tard, la famille réussit à obtenir les visas nécessaires. Cependant, le vaccin russe contre la COVID reçu par Elena n’est pas reconnu au Canada. Elle tente désespérément de trouver un endroit en Europe pour recevoir un autre vaccin lorsqu’un employé d’un ministère canadien l’informe qu’elle pourrait simplement faire une quarantaine au lieu de recevoir le vaccin.
L’information s’avère complètement fausse. La famille est interceptée en Italie, où elle fait escale, puis est déportée en Turquie. « C’était vraiment dégueulasse », souligne Nikolaï. À cause de la guerre lancée par la Russie, des sanctions économiques sont en place et il est impossible de changer leur argent à l’aéroport. « Le petit pleurait. Elle ne pouvait même pas acheter une bouteille d’eau pour les enfants. » La famille ne recevra ni excuses ni remboursement pour cette bévue d’un fonctionnaire canadien.
Quelques jours plus tard, Elena réussit à obtenir le vaccin tant convoité. Avec ses enfants, elle est alors libre de s’envoler vers le Canada. Ils-elles atterrissent exténué-es à Montréal le 14 mai, 60 jours exactement après leur arrivée en Turquie. Pari réussi.
Trois ans plus tard
La famille est toujours installée au Québec, qu’elle aime beaucoup. Lorsque je lui demande si elle voudrait rentrer en Russie, Elena me dit qu’elle le ferait seulement pour visiter ses proches, mais jamais pour rester.
Le clan trouve les gens d’ici très accueillants : « Les gens qui nous entourent sont très bienveillants, très ouverts », explique Nikolaï. Le couple voit en somme beaucoup de similitudes entre la Russie et le Québec, un autre pays nordique et laïc. « On voit les mêmes gens avec les mêmes problèmes ; la différence, c’est le régime, parce qu’ici, c’est mieux qu’en Russie », souligne Elena.
Au départ, leur seule grande difficulté a été le français, mais Elena a maintenant terminé le plus haut niveau de francisation, Léra est sur le point de franchir le même cap et Andreï vient d’intégrer une classe régulière.
Ils-elles sont bien content-es de leurs expériences humaines ici, mais ce n’est pas le cas en ce qui concerne leurs contacts avec les institutions. Le système n’est pas tendre envers Léra, une jeune femme trans, qui aurait besoin d’un traitement hormonal de substitution. (Nous y reviendrons dans une chronique subséquente.) La demande d’asile des quatre membres de la famille, envoyée en mai 2024, progresse lentement. Le système les bouscule, les accrochages sont constants, mais ils-elles se croisent les doigts en espérant une audience cet automne.
Au moment de clore l’entrevue, Elena est émue. Il est évident que cette plongée dans ces souvenirs de séparation douloureuse l’a ébranlée, mais elle tient à souligner qu’au final, ils et elles ont de la chance d’être bien loin des bombes que les Ukrainiens et Ukrainiennes reçoivent sur la tête et, surtout, la famille est réunie. Enfin.