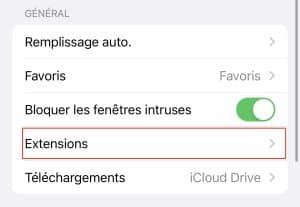L’épisode de rentrée de la sixième saison de La tête dans les nuances aborde la parité hommes-femmes en politique et les réalités vécues par les élues. À quelques semaines des élections municipales, l’animateur Robert Robin reçoit trois invitées : Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme, Geneviève Auclair, conseillère municipale à Trois-Rivières, et Esther Lapointe, directrice générale du groupe Femmes, politique et démocratie. La question du double standard entre hommes et femmes constitue le fil conducteur de l’échange, mais ce n’est pas le seul thème abordé : les invitées discutent aussi de la solidarité féminine, des moyens d’atteindre la parité et de la différence entre engagement et carriérisme en politique.
Le double standard : s’efface-t-il ou s’accroît-il ?
Les participantes s’entendent pour dire que le double standard existe toujours. Les femmes en politique doivent souvent être irréprochables : un faux pas, une émotion exprimée, un style vestimentaire jugé « inadéquat » et leur crédibilité est immédiatement remise en cause. Cette pression pèse plus lourdement sur elles que sur leurs homologues masculins. Pour autant, difficile de dire si ce phénomène tend à diminuer ou à s’aggraver.
La force du nombre et la solidarité
Selon Louise Cordeau et Esther Lapointe, c’est surtout la force du nombre qui permettra de transformer la culture politique. Plus il y aura de femmes présentes, plus les normes se diversifieront et moins il sera nécessaire d’adopter un modèle calqué sur celui des hommes.
La discussion met également en lumière la solidarité naturelle entre femmes en politique. À l’Assemblée nationale, par exemple, plusieurs réformes majeures comme celle de l’équité salariale ou la modification des règles touchant le patrimoine familial ont vu le jour grâce à des alliances transpartisanes de députées. Cette tendance s’explique par une moindre partisanerie chez les femmes : elles sont plus enclines à collaborer au-delà des lignes de parti pour défendre des causes communes.
Geneviève Auclair souligne toutefois que cette force reste fragile dans les conseils municipaux où les élues sont minoritaires. À Trois-Rivières, par exemple, seulement 4 femmes siègent sur 15 élu-es, ce qui les rend « presque invisibles » autour de la table du conseil. Pourtant, lorsqu’elles prennent leur place, elles apportent une voix différente, souvent plus axée sur l’écoute et la recherche de solutions.
La force du nombre se manifeste aussi dans la capacité à créer et à entretenir des réseaux de soutien. Ces espaces permettent aux élues d’échanger sur leurs expériences, de partager des conseils et de trouver un appui moral face aux difficultés. Or, comme le rappellent les intervenantes, les femmes sont souvent moins présentes dans les lieux traditionnels de réseautage, comme les chambres de commerce, par exemple. Ces réseaux sont essentiels pour briser l’isolement, renforcer la confiance et favoriser ainsi la rétention des femmes en politique.
Légiférer ou éduquer ?
La question de la stratégie à adopter pour atteindre la parité divise : faut-il miser sur l’éducation et la sensibilisation ou plutôt sur des mesures contraignantes ? Pour Esther Lapointe, l’éducation seule ne suffit pas. De nombreux pays ont légiféré pour instaurer des quotas, et cela a permis d’accélérer les choses. Au Québec, l’exemple des conseils d’administration des sociétés d’État est éloquent : grâce à une loi, ils sont devenus paritaires et cette réalité est désormais entrée dans les mœurs. Louise Cordeau confirme que l’adoption d’un cadre légal est un levier puissant.
À l’inverse, dans le monde municipal, où les partis sont souvent absents, la mise en place de règles strictes est plus complexe. Certaines pistes comme la réservation de sièges par genre sont évoquées, mais elles suscitent encore des débats. Toutes s’entendent toutefois pour dire que laisser évoluer la situation « naturellement » risquerait de prolonger la situation pendant des décennies, voire de nous faire reculer sur certains acquis.
L’engagement plutôt que la carrière
Enfin, les invitées insistent sur ce qui semble une différence fondamentale entre les motivations des hommes et celles des femmes en politique. Les femmes qui font le saut sont rarement carriéristes. Leur démarche relève davantage de l’engagement citoyen. Elles veulent améliorer leur milieu de vie, rapprocher les gens de la politique et contribuer au bien commun. Cette approche entraîne un rapport différent au pouvoir, moins centré sur le statut qu’il procure et plus sur la possibilité qu’il offre de faire des changements concrets.
On explique aussi pourquoi certaines élues quittent leur poste après seulement un mandat. Selon une étude, la principale raison évoquée par les femmes qui se retirent est le sentiment d’inutilité. Après avoir investi énormément d’énergie, elles estiment parfois que leur voix ne porte pas, ou que les attaques – notamment en ligne – deviennent trop lourdes à supporter.
À travers ces échanges, un constat s’impose : la parité en politique n’est pas qu’une question de chiffres, mais bien aussi de culture et de pratiques. Le double standard persiste, mais il pourra s’atténuer grâce à la diversité croissante des modèles féminins. Pour accélérer ce changement, l’éducation reste essentielle, mais la législation apparaît comme un levier incontournable. Enfin, la politique au féminin se distingue par une approche axée sur l’engagement plutôt que sur la carrière, une orientation porteuse d’un autre style, moins partisan et plus collaboratif, dont la démocratie pourrait largement bénéficier.
 « On n’est drôlement pas obligées d’agir comme un homme. Et une société doit faire de la place à tout le monde. Alors, dans cette diversité aussi, je pense que les femmes prennent de moins en moins le rôle que les hommes souhaitent qu’elles aient. »
« On n’est drôlement pas obligées d’agir comme un homme. Et une société doit faire de la place à tout le monde. Alors, dans cette diversité aussi, je pense que les femmes prennent de moins en moins le rôle que les hommes souhaitent qu’elles aient. »
– Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme
 « On le fait pour l’engagement, pas pour le pouvoir et pas parce qu’on a eu une carrière et qu’on le mérite. On voit ça parfois chez les hommes : ils ont eu une carrière et maintenant ils pensent qu’ils méritent un poste de conseiller municipal. Moi, c’était vraiment pour la communauté, pour rapprocher les gens de la politique. »
« On le fait pour l’engagement, pas pour le pouvoir et pas parce qu’on a eu une carrière et qu’on le mérite. On voit ça parfois chez les hommes : ils ont eu une carrière et maintenant ils pensent qu’ils méritent un poste de conseiller municipal. Moi, c’était vraiment pour la communauté, pour rapprocher les gens de la politique. »
– Geneviève Auclair, conseillère municipale du district Saint-Louis-de-France à Trois-Rivières.
 « On sait que les hommes sont présents, que les règles ont été établies par les hommes, que les structures et la culture sont masculines, et nous, on arrive et il faudrait tout faire changer ça ? Ce n’est pas évident, à moins qu’on soit en nombre suffisant. »
« On sait que les hommes sont présents, que les règles ont été établies par les hommes, que les structures et la culture sont masculines, et nous, on arrive et il faudrait tout faire changer ça ? Ce n’est pas évident, à moins qu’on soit en nombre suffisant. »
– Esther Lapointe, directrice générale du groupe Femmes, politique et démocratie
Photos : Anne-Sofie Bathalon