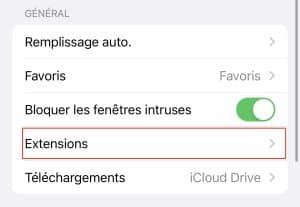Pour La Gazette, j’ai rencontré David Laplante, directeur général du centre Le Grand Chemin spécialisé dans le milieu de la dépendance chez les jeunes. En l’écoutant parler, on sent tout le vécu et toute la passion qu’il met dans son travail. Il croit sincèrement que ça prend un vrai leadership pour avancer et que le réseau communautaire doit être reconnu à sa juste valeur dans les trajectoires de services. Un témoignage empreint de clarté et de cœur et qui met de l’avant les défis dont on ne parle pas souvent dans la sphère publique.
Alors voici ce qu’il m’a confié.
Je m’appelle David Laplante. Ça fait déjà 30 ans que je travaille dans le domaine de la dépendance, plus particulièrement au Grand Chemin. J’ai commencé comme intervenant pendant une dizaine d’années, puis j’ai monté les échelons tranquillement. J’ai été coordonnateur pendant une autre dizaine d’années, puis, depuis 2012, je suis directeur général des trois centres du Grand Chemin. On aide des jeunes de 12 à 17 ans qui ont des problèmes de dépendance aux drogues et à l’alcool en plus d’aider les jeunes ayant une problématique de cyberdépendnace et de jeu excessif. Chaque année, on accueille environ 200 jeunes de partout au Québec, des gars (60 %) et des filles (40 %) dont la moyenne d’âge est d’environ 15 ans.
Le Grand Chemin, c’est un endroit où on leur offre des thérapies intensives de 8 à 10 semaines. Pendant ce temps-là, on travaille aussi avec leurs familles parce qu’on sait à quel point c’est important de bien les préparer au retour des jeunes à la maison. On a aussi des services scolaires pour ne pas que les jeunes décrochent complètement pendant leur thérapie. C’est un accompagnement complet.
Ce qui me frappe toujours, c’est à quel point la problématique évolue rapidement chez les adolescents et les adolescentes. Les jeunes que l’on reçoit commencent souvent à consommer des drogues ou de l’alcool vers 11-12 ans, ils en consomment abusivement vers 13-14 ans, puis ils arrivent chez nous autour de 15 ans. En trois, quatre ans, les ados passent d’une consommation « pour essayer » à une consommation abusive. C’est clairement le cannabis qui est le plus consommé – 99 % de nos jeunes en consomment chaque jour, suivi de l’alcool et d’autres stupéfiants (amphétamines, hallucinogènes, cocaïne).
Quand la légalisation est arrivée, je ne te cacherai pas que ça m’a un peu ébranlé. Surtout en lien avec la perception du risque et de l’accessibilité. Mais avec du recul, j’ai compris que ça ne changeait pas tant la donne pour les jeunes. Ils y avaient déjà accès bien avant que ça devienne légal. Le nombre de consommateurs et de consommatrices n’a pas augmenté et il faut toujours travailler aussi fort pour les amener en traitement. La légalisation a apporté du bon, en regard du contrôle de la qualité et d’une meilleure information sur les produits consommés.
J’ai vu les tendances changer au fil des années. Au début, en 1994, c’était beaucoup des jeunes de 16-17 ans qui fumaient du cannabis qui venaient en thérapie, puis c’est passé aux buvards, et aux amphétamines avec la mode des raves autour des années 2000. La moyenne d’âge a diminué et on a vu l’apparition des troubles concomitants (santé mentale et dépendance) et donc une plus grande complexité dans le traitement. On a dû adapter la thérapie à chaque profil. L’approche one size fits all ne pouvait plus exister. Mais depuis une quinzaine d’années, ça s’est stabilisé. Le portrait reste pas mal le même en termes de types de consommation et de profils
Ce qui a changé aussi, c’est la prise de risque. La prévention a porté fruit. Les jeunes aujourd’hui connaissent peut-être un peu mieux ce qu’ils consomment, savent plus ce qu’ils prennent, s’informent, sont plus éduqués là-dessus. Mais même avec toute cette évolution, il y a des défis énormes, surtout comme organisme communautaire.
Le plus grand défi que j’ai aujourd’hui, c’est de garder nos intervenants et intervenantes. On a un défi d’attraction et de rétention du personnel. Le réseau de la santé offre des salaires beaucoup plus élevés, parfois 25 % à 35 % de plus que ce qu’on peut offrir. Ça devient difficile de rivaliser. Quand tu as un technicien ou ne technicienne en éducation spécialisée qui rentre chez nous à 21,75 $ de l’heure, alors qu’on lui offre ailleurs 27 $ pour sensiblement le même boulot, tu réalises vite que tu risques de perdre du monde.
Ça fait mal, parce que ce qui est le plus important dans notre travail, c’est le lien de confiance. Ce lien-là, tu ne peux pas le bâtir si t’as du roulement de personnel constamment. Il se bâtit en ayant un bon mélange d’expériences. Chaque fois que quelqu’un d’expérimenté part, ça ébranle l’équipe mais aussi la clientèle, ça nuit à la qualité des services.
Notre organisme communautaire doit avoir des exigences de qualité aussi élevées que celles du réseau public, mais sans avoir les mêmes moyens. On nous demande, avec raison, d’être aussi performants en termes de procédures, de plan d’intervention et d’engagement dans un processus de certification aux quatre ans… mais avec un budget très serré. On offre des services que le réseau public n’offre pas, on est complémentaires, mais avec des moyens limités.
Je le dis depuis longtemps : il faut mieux intégrer le communautaire dans la trajectoire des services publics. On fait partie de la solution. On prend en charge des jeunes que le réseau ne peut pas accueillir, et on leur offre des soins de qualité de façon complémentaire. La complémentarité du réseau public et du réseau communautaire doit être reconnue à sa juste valeur. Il est essentiel qu’on fasse partie intégrante des orientations en santé, mais aussi des décisions budgétaires qui en découlent. Sans un financement adéquat et récurrent, notre contribution ne pourra jamais être pleinement déployée. Je suis d’avis que les services communautaires ont la possibilité de réduire la pression sur le réseau public en tant que partenaire.
Je sais qu’il y a des politiciens et des politiciennes qui comprennent l’importance du communautaire. Mais trop souvent, on réagit seulement quand il y a un scandale ou quand les médias s’en mêlent. Il faut changer cette dynamique. Il faut être proactifs, réfléchir à la vision qu’on veut pour le Québec et inclure le communautaire dès le départ. Travailler ensemble, du dépistage jusqu’à la réinsertion sociale, main dans la main. Parce qu’au final, c’est cette collaboration qui va vraiment faire une différence.