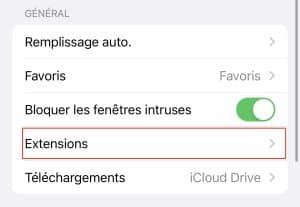Il ne se passe pas une semaine sans qu’on entende parler d’équité, de diversité ou d’inclusion dans l’espace médiatique. Ces concepts, qu’on regroupe souvent sous l’acronyme EDI, font désormais partie du vocabulaire public. On en parle dans les écoles, les institutions, les entreprises, partout. Parfois pour les défendre, souvent pour les critiquer. Ces dernières années, plusieurs gros titres ont fait couler beaucoup d’encre. On a vu plusieurs grandes entreprises reculer dans leurs actions ou tout simplement abolir leurs politiques d’EDI : pensons notamment à Walmart, Target, Google, Disney, McDonald’s et Ford.
On entend dire que « ça va trop loin », que « c’est exagéré », qu’« on ne peut plus rien dire ». Ce genre de discours, je les entends aussi dans le cadre de mon travail, sur le terrain. Ces propos ne sont pas toujours teintés de mépris. En effet, la plupart du temps, les gens ont seulement des questions ou des incompréhensions, et ressentent la peur de se tromper ou d’être jugés. Parfois, ces personnes ont entendu une controverse à la radio ou vu un extrait d’une vidéo sur les réseaux sociaux, et en ont déduit que l’inclusion est une idéologie qui ne sert qu’à un petit groupe de personnes. Ces personnes n’ont pas toujours eu la chance de creuser ces enjeux en profondeur.
Et c’est précisément là que commence le véritable travail, soit celui de parler avec des gens qui ont une idée basée sur des sources questionnables, sans les brusquer mais sans non plus mettre de côté la rigueur et la réalité. Il faut accueillir les questions, surtout les plus maladroites, et transformer les résistances en occasions de dialogue. Car si tout le monde a une opinion sur l’inclusion, il faut aussi savoir distinguer l’opinion du fait et de l’expertise. Et ça, ce n’est pas évident à une époque où tout le monde a un micro, mais pas toujours les outils pour valider ses sources.
Des discussions sans confrontation
Dans mon quotidien, je rencontre des gens curieux, parfois sceptiques, mais souvent mal informés. Leur résistance n’est pas toujours de mauvaise foi. Ils n’ont simplement jamais eu accès à d’autres perspectives. Alors, plutôt que de les contredire de manière frontale, j’adopte une posture d’écoute et de questionnement qu’on appelle entretien épistémique. Le processus est assez simple, mais il peut prendre du temps. En fait, il s’agit de s’interroger sur le cheminement que la personne a fait pour arriver à la croyance qu’elle entretient. Le but est que la personne en vienne à questionner son propre processus et ainsi à douter ou, mieux encore, à abandonner sa fausse croyance.
Quand une personne exprime une opinion que je sais problématique ou mal informée, je ne commence pas par la corriger. Je commence par l’écouter. La première étape, c’est souvent de reformuler ce que la personne vient de dire : « Si je comprends bien, tu dis que… ». Cette phrase change automatiquement l’ambiance. Elle montre que je ne suis pas là pour juger, mais pour comprendre. Ensuite, j’essaie de savoir d’où vient cette idée : « Comment en es-tu arrivé-e à cette conclusion ? », ou encore « Qu’est-ce qui t’a fait croire que c’est comme ça ? ». Ces questions permettent à la personne de réfléchir à son propre raisonnement. Très souvent, on se rend compte que nos croyances viennent d’une anecdote, d’un article lu en diagonale ou d’un propos entendu dans notre entourage. On peut ainsi les remettre en doute.
Créer des ponts
Enfin, un outil que j’utilise souvent, surtout dans des discussions tendues, c’est de revenir à des valeurs communes : « Je pense que toi et moi on veut une société juste, non ? ». Cela rappelle que, malgré nos divergences d’opinions, on partage souvent des intentions similaires. Et quand on part de ce terrain commun, on peut avancer ensemble, lentement mais sûrement, vers une meilleure compréhension.
Quand j’utilise cette approche, je ne cherche pas à gagner une discussion. Je pose des questions, j’essaie de comprendre ce qui amène la personne à croire ce qu’elle croit. Cette façon de faire demande du temps, de la patience et surtout de la bienveillance, mais elle peut être très efficace. Quand une personne se sent écoutée et respectée, elle est beaucoup plus encline à discuter. Et, parfois, c’est tout ce qu’il faut pour amorcer un changement de perspective. L’entretien épistémique ne remplacera jamais les luttes et les mobilisations collectives. Cependant, dans l’intimité d’une conversation, il a ce pouvoir subtil, mais assez fort, de faire évoluer les conversations. Et à une époque saturée de jugements et de divisions, c’est peut-être déjà beaucoup.