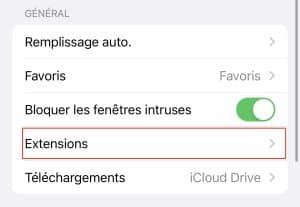Vous connaissez le corégone ? Ce poisson blanc qui habite dans les eaux douces des rivières et des lacs froids du Québec et du Canada ? Ce même poisson blanc que l’on trouve à trois reprises sur les armoiries de Trois-Rivières?
Sur les armoiries de la Ville, les corégones symbolisent les trois rivières, cette illusion d’optique qui fait référence aux trois chenaux de la rivière Saint-Maurice. Mais, plus précisément, le corégone est aussi le totem de la communauté atikamekw, les premiers occupants des lieux. Cette appellation serait apparue parce qu’ils étaient de grands consommateurs de ce poisson blanc.
Les Atikamekw sont issus de la grande famille Anicnape. Ils sont une nation de tradition orale et de culture algonquine. Ils appartiennent donc à l’une des 11 nations qui peuplent le territoire québécois. Or, ils occupent un vaste territoire qui couvre le bassin versant de Tapiskwan Sipi (la rivière Saint-Maurice) et une partie des bassins versants de la baie James, de Katino Sipi (la rivière Gatineau) et de Wapoc Sipi (la rivière La Lièvre).
Pour cette chronique, je me suis intéressé à l’occupation du territoire des Atikamekw, avant les années 1900, de la Haute-Mauricie une région géographique située au nord de La Tuque.
L’occupation du territoire ancestral des Atikamekw
Avant d’entrer en contact avec les Allochtones, les Atikamekw étaient des chasseurs-cueilleurs nomades qui se déplaçaient sur de longues distances pour leur subsistance. Ce faisant, ils pêchaient, chassaient le gros gibier comme l’orignal ou le caribou, trappaient et cueillaient des petits fruits sauvages. « Ils faisaient aussi du troc avec les Cris, les Algonquins et les Montagnais. Ils recevaient du maïs des Abénaquis en échange de gibier et de poisson. Au printemps, ils faisaient bouillir la sève d’érable pour en faire du sucre et du sirop. Les Atikamekw ont aussi fait le commerce des fourrures avec les colons dans les années 1700. »
Selon le Conseil de la nation atikamekw, on estime que vers 1650 le nombre d’Atikamekw vivant en Haute-Mauricie se situait entre 500 et 600.
À l’époque coloniale, le commerce des fourrures s’accentue progressivement avec l’implantation des comptoirs de traite dans la région. Les Atikamekw « se déplaçaient et chassaient en groupe pour traquer les animaux qui se déplaçaient sur de grandes distances ». Dans ces conditions, le mode d’occupation du territoire « passe progressivement d’une tenure collective à une tenure plus individualisée ». Selon l’anthropologue Roland Viau, « […] l’importance de contrôler certains territoires et de s’assurer des droits exclusifs sur le territoire [sic] qui s’y trouve devient impératif ». Autrement dit, ils doivent réorganiser leur présence et leurs pratiques sur le territoire tout en modifiant leur distribution spatiale.
Au début du XIXe siècle, l’ouverture des comptoirs des compagnies du Nord-Ouest et de la Baie d’Hudson dans la région entraîne les Atikamekw à changer peu à peu leur pratique de chasse pour se concentrer davantage sur le piégeage d’animaux à fourrure, comme le castor, très prisé des Allochtones. Même si les échanges commerciaux s’intensifient, les Atikamekw resteront, pour la plupart, des chasseurs-cueilleurs nomades tout au long du siècle.
Toutefois, vers 1830, de nombreux Atikamekw vont travailler dans l’industrie forestière et même pour des compagnies productrices d’électricité.
À partir du milieu du XIXe siècle, leur mode de vie, déjà bouleversé par la colonisation, sera perturbé à nouveau. En effet, de nombreux Allochtones viendront s’établir en Haute-Mauricie en raison de l’exploitation des ressources naturelles, dont celle que fait l’industrie forestière. Par ailleurs, cette dernière empiète graduellement sur le territoire ancestral des Atikamekw, ce qui va changer leur rapport avec celui-ci. Et il ne faut pas oublier la Loi sur les Indiens de 1876, qui définit encore aujourd’hui leur mode d’organisation et d’administration et la création des pensionnats autochtones en 1883.
Chez les Atikamekw, le territoire n’est pas qu’un simple espace physique. Il est bien plus que cela. « Ils y développent un état de conscience émotionnelle et subjective. Le territoire s’inscrit à l’intérieur de trames narratives, de récits et de croyances issus de la mosaïque des relations physiques et métaphysiques que les Atikamekw entretiennent entre eux et avec la nature. Ce mode de représentation territoriale détermine à la fois leur manière d’être, de penser et de vivre […]. »
En somme, l’accès à leur territoire et à ses ressources se modifie de plus en plus en raison des activités industrielles. Par conséquent, il devient difficile pour eux de poursuivre leurs pratiques ancestrales. Parallèlement, leur dépossession s’accentue de plus en plus à la fin du XIXe siècle pour atteindre le point culminant entre 1900 et 1930. C’est donc le début de la déterritorialisation.