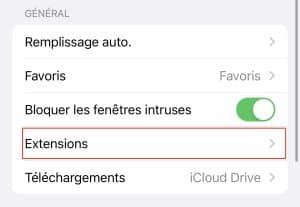Récemment, à la chapelle de l’église de Saint-Léon-le-Grand, se tenait l’événement Rêvons nos églises organisé par la MRC de Maskinongé. Celle-ci offrait gratuitement deux conférences sur le processus de conversion des lieux de culte tout en présentant des exemples concrets et inspirants. Cet événement visait à stimuler la réflexion collective et à sensibiliser la population à l’importance de préserver ces lieux chargés d’histoire.
La Gazette a rencontré Isabelle Lortie, directrice adjointe du Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ), qui a livré une conférence approfondie sur le processus de conversion des églises.
Isabelle Lortie indique que, depuis la pandémie, ce phénomène s’est accéléré. En effet, depuis 2020, une cinquantaine d’églises seraient en mutation. Bien souvent, ce sont des projets d’envergure qui nécessitent beaucoup de réflexion. Du fait de leur singularité, ces bâtiments font aussi l’objet d’une conversion dont l’aboutissement est unique chaque fois. « Il n’y a pas de recette précise, c’est toujours du cas par cas, bien qu’on s’inspire de projets qui ont été réalisés », précise Mme Lortie.
Plusieurs éléments font partie du processus et peuvent s’appliquer à différentes étapes d’un projet. « Certaines Municipalités achètent des bâtiments et font une analyse des besoins auprès de la population, d’autres se chargent de toutes les étapes et acquièrent le bâtiment par après. Ça dépend toujours des projets », souligne Isabelle Lortie.
À lire : Des reconversions inspirantes en Mauricie, au Centre-du-Québec et dans Lanaudière
Le diagnostic initial
L’état des lieux est l’un des éléments fondamentaux du processus de conversion. Il s’agit de dresser un portrait technique et patrimonial du bâtiment : état de la structure, valeur historique et architecturale, accessibilité, etc.
L’analyse des besoins
Le succès d’une conversion repose souvent sur la capacité à ancrer le projet dans le tissu social local. Ainsi, une consultation peut être menée auprès de la population locale, des autorités municipales, des organismes communautaires et des gens du milieu culturel ou économique. Cette étape permet de recenser les besoins du milieu et de réfléchir collectivement aux usages possibles du bâtiment : centre communautaire, salle de spectacle, bibliothèque, logements, etc.
Le montage financier et la recherche de partenaires
La conversion d’un lieu de culte nécessite des investissements importants. Il faut donc établir un montage financier, lequel peut inclure des subventions gouvernementales, des campagnes de financement, des partenariats avec des entreprises ou des coopératives, ainsi que la collaboration citoyenne. À ce stade, la crédibilité du projet et la qualité des partenariats déterminent en grande partie son avenir.
L’évaluation de la faisabilité
À partir des besoins identifiés, on réalise une étude de faisabilité, qui comprend des analyses financières, techniques et juridiques. Peut-on transformer l’église sans dénaturer son architecture ? Quelles sont les contraintes liées au zonage ? Le projet est-il économiquement viable ? Faut-il engager un promoteur privé ou maintenir une gestion communautaire ? Ce sont quelques-unes des questions qui peuvent être soulevées à cette étape cruciale, ce qui permet d’élaborer un plan réaliste pour la conversion.
La désacralisation
En parallèle, la corporation propriétaire de l’église, le plus souvent une fabrique ou un diocèse, doit procéder à la désacralisation du lieu, une démarche symbolique et administrative qui marque la fin de l’usage religieux. Cette étape est essentielle, car elle permet d’envisager un nouvel usage du bâtiment sans trahir sa vocation initiale. D’autant plus que pour obtenir des fonds de la part du CPRQ, la nouvelle vocation du bâtiment doit être laïque.
La mise en œuvre et l’appropriation
Une fois le financement réuni et les autorisations obtenues, les travaux de transformation peuvent commencer. On vise à préserver le cachet patrimonial tout en adaptant le bâtiment à de nouveaux usages. L’appropriation par la collectivité est également essentielle : un lieu réinventé ne prend vie que s’il devient un espace vivant, fréquenté et porteur de sens.
Pour Isabelle Lortie, « c’est cela qui fait la beauté de la chose », c’est-à-dire la conversion, la revalorisation et l’appropriation d’un nouveau lieu communautaire tout en conservant le plus possible le cachet original de l’édifice.