Dans le cadre de son 40e anniversaire, La Gazette de la Mauricie et des environs a la chance de compter sur des ambassadrices et des ambassadeurs de différents horizons qui sont des personnes significatives dans notre collectivité. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre de Christian Blanchette, recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) !
Quels sont les principaux enjeux de l’éducation universitaire que l’UQTR priorise à l’heure actuelle?
C’est l’heure de la rentrée donc, c’est l’accueil de nos étudiant-es. On a plusieurs milliers qui arrivent et près de 3 000 qui seront nouveaux. C’est la première fois qu’ils viennent à l’université. Beaucoup viennent à la fois de la région de la Mauricie et d’ailleurs. 60 % de nos étudiants ont une adresse permanente qui est plus éloignée d’une heure du campus de Trois-Rivières. La priorité de l’UQTR dans les prochaines semaines, c’est l’accueil de nos étudiants mais il y a bien d’autres réponses à donner à cette question-là.
Le numérique occupe de plus en plus de place en éducation. Ses avancées sont-elles un soutien ou plutôt un frein au système éducatif?
Vous posez la question à quelqu’un qui a fait une grande partie de sa carrière sur la transformation numérique des universités. Pour l’apprentissage, beaucoup de recherches montrent que le numérique a un effet qui est soit neutre ou positif. Bien sûr, quand on parle de jeunes enfants, c’est autre chose. Mais dans le monde universitaire, il y a vraiment un potentiel important.
Les populations qui fréquentent l’université sont très variées et c’est de 36 à 40 % des étudiants qui fréquentent l’université qui la fréquentent à temps partiel. Ce sont souvent des gens qui travaillent, ont des familles et fréquentent l’université pour obtenir un premier baccalauréat en faisant un cumul de certificats ou viennent compléter des formations plus courtes. On doit pouvoir trouver des manières de servir à la fois une population plus jeune qui demande une expérience différente et un contexte d’apprentissage différent, mais aussi penser qu’on a un rôle d’accès qui est beaucoup plus large. Quand on examine et on réfléchit la pédagogie, l’intégration du présentiel et de portions d’apprentissage en ligne est souvent extrêmement intéressante parce que toutes les ressources documentaires sont là et il y a des moyens de faire des parcours pédagogiques absolument extraordinaires avec le numérique.
Quelle importance occupe la recherche à l’UQTR?
La recherche, c’est une manière de contribuer au savoir, mais aussi de se donner les niches d’excellence. Ça nous permet d’amener les étudiant-es à se poser les toutes dernières questions puis d’y réfléchir parce que ces étudiantes, ces étudiants vont devenir les prochains professeur-es d’université peut-être, mais aussi des citoyen-nes qui devront se poser les bonnes questions. Pour l’UQTR, d’une manière plus structurelle, notre recherche est de plus en plus intensive. Les sommes que nos élu-es se sont attirées pour financer la recherche sont en croissance constante. Nous étions jusqu’à l’année dernière considérée comme une université principalement de premier cycle. Maintenant, nous sommes entrés dans la catégorie des universités à vocation intensive de recherche.
Quels sont les impacts d’une diminution des étudiants internationaux sur le réseau universitaire?
Elles sont multiples et il faut, pour les mesurer, comprendre ce qu’est l’apport des étudiant-es internationaux dans une université. Notre campus principal est en région ici à Trois-Rivières avec d’autres à Drummondville, Joliette, L’Assomption, Terrebonne, Longueuil et Québec. Mais quand on prend simplement à Trois-Rivières, c’est à peu près 4 % de la population qui est issue de minorités visibles. On avait l’année dernière 18 % de nos étudiant-es qui étaient des étudiants internationaux et 13 % de nos professeur-es qui se sont déclarés, il y a trois ans, être issus d’une minorité visible. Donc, on est un vecteur de diversité et d’internationalisation. Les étudiant-es internationaux qui sont présent-es ici, nous permettent d’internationaliser l’expérience d’études à l’UQTR. C’est une exposition à l’international, à travers les étudiants internationaux qui est extraordinaire! Et pour la recherche, c’est fondamental, parce que dans les niches hautement spécialisées souvent, c’est 70 % des étudiant-es qui participent aux projets de recherche qui viennent de l’international.
Comment peut-on favoriser une plus grande accessibilité aux études universitaires?
L’UQTR, c’est encore un étudiant sur deux qui est un étudiant de première génération, ce qui veut dire que personne dans sa famille n’est allé à l’université. La mission sociale de notre université, de l’UQTR, elle est là : donner accès. Moi, je suis un étudiant de première génération. Je viens du Plateau-Mont-Royal, d’une famille d’ouvriers et personne dans ma famille n’est allé à l’université et je me retrouve recteur. Le système québécois de donner accès fonctionne et l’UQTR joue ce rôle-là plein et entier en offrant des programmes localement. Au Québec, on a des droits de scolarité qui, en comparaison aux autres lieux à travers la planète, sont bas même s’ils apparaissent élevés. Le vrai coût, il est encore plus grand avec tout ce qui entoure la participation aux études. Il faut qu’on considère ça dans l’attribution des bourses, dans la compréhension de ce que sont les coûts des études et globalement chercher à diminuer ces coûts. Ça veut peut-être dire diminuer encore les droits de scolarité. Ça veut surtout dire, je pense, qu’on aurait un impact beaucoup plus grand si on pouvait construire encore plus de résidences, en réduire les coûts et permettre aux étudiant-es d’étudier dans leur région.
Pourquoi avez-vous accepté d’être ambassadeur de La Gazette?
La Gazette est au cœur de la démocratie. De bien comprendre ce que sont les enjeux sociaux, de lire des points de vue qui sont différents… c’est particulièrement important! Et on est dans un moment où il y a un effritement complet de l’accès au journalisme, à des idées nouvelles et surtout à un effacement des régions. Les médias dominants sont des médias qui deviennent nationaux. La Gazette de la Mauricie fait partie des médias régionaux qui restent. Et il est important qu’on l’encourage parce qu’ils nous donnent le point de vue de ce que nous sommes. Sinon, je vais le dire bêtement mais ça ne sera que le point de vue de Montréal qui nous viendra. Et c’est un point de vue qui est complètement différent de notre réalité.
Pourquoi devrait-on lire et faire un don à La Gazette?
Parce qu’il faut maintenir bien vivant, ce que sont les médias régionaux. Pour nous, en Mauricie, c’est La Gazette, et donc je vous l’encourage. On sait combien l’enjeu du financement des médias et des modèles commerciaux qui, eux aussi, orientent les points de vue journalistiques, combien ces modèles commerciaux ont un impact. Le don et la philanthropie, sans attendre quoi que ce soit de retour, c’est un beau geste pour la Mauricie à travers La Gazette !







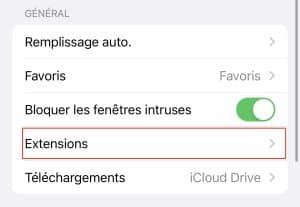

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Se connecter