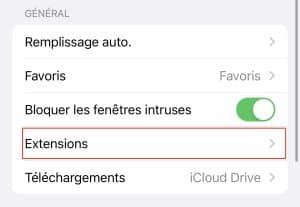Un texte de Karolann St-Amand, collaboratrice
Un texte de Karolann St-Amand, collaboratrice
Lauréate de la bourse Denis-Charland décernée par l’Atelier Presse Papier et la revue Le Sabord, l’artiste Pekuakamiulnu Patricia Langevin nous partage son parcours artistique des dernières années et de l’importance d’ouvrir la communication.
En 2022, Patricia Langevin entame un retour aux études au baccalauréat en arts visuels à l’Université du Québec à Trois-Rivières, bouleversée par l’onde de choc du décès de Joyce Echaquan et la découverte des premières fosses communes liées aux pensionnats autochtones. « C’est vraiment avec la rage en dedans, par besoin de faire voir les injustices, mais aussi d’exprimer les droits des membres des Premières Nations » qu’elle s’est lancée dans les études universitaires, confie-t-elle. La colère première devient une quête créative engagée, d’abord collective – par la confection de jupes de guérison avec sa famille pendant la pandémie, une initiative du Comité des femmes de la communauté de Mashteuiatsh — puis de plus en plus personnelle, en travaillant toujours la transmission identitaire et culturelle par les femmes. Le baccalauréat lui a notamment permis de découvrir de nouvelles techniques, dont le verre soufflé : « c’est le cours qui a probablement le plus marqué mon parcours en art, je l’ai refait trois années de suite ». C’est d’ailleurs son projet de fin de programme, Tipelimitishun/Liberté, qui a été retenu pour la bourse Denis-Charland. Il constitue en outre une période charnière dans la pratique de l’artiste, qui se tourne vers une esthétique du care, « autant par rapport à [s]oi, prendre soin de [s]oi, la guérison, mais aussi des femmes, du passé transgénérationnel, du futur intergénérationnel ». Patricia Langevin précise : « C’est la première œuvre que j’ai élaborée en passant de la colère à la lumière ». Le perlage y révèle une tension entre attentes identitaires et engagement personnel. L’objectif de l’artiste est d’honorer le passage des femmes qui l’ont précédée, de sa famille et de sa communauté. Elle souhaite canaliser la douleur et la frustration qui l’ont habitée pour mettre en lumière la beauté qui en découle.
Un art au croisement des appartenances
Issue d’un milieu franco-québécois et innu, Patricia Langevin grandit entre son quotidien à Québec et les séjours chez ses grands-parents, sur la réserve à Mashteuiatsh, au Pekuagami (Lac-Saint-Jean). De mère en fille, elle apprend à coudre, à cuisiner, à créer de ses mains – gestes d’abord simples, qui deviennent fondateurs : « Créer, c’est devenu une manière de me raccrocher à la famille, à la mémoire ».
Aujourd’hui, cette double appartenance cohabite dans ses créations : « Il s’agit de mixer ces identités-là pour les amener à se découvrir ». Ce croisement donne lieu à des œuvres hybrides, réalisées à partir de matériaux traditionnels (perlage, tissage, broderie) et de plusieurs médiums comme le verre soufflé, l’art textile, l’aquarelle, la sérigraphie, le verre soufflé, la gravure, mais aussi la réalité augmentée et l’installation. L’artiste « essaie de créer une rencontre. Il y a quelque chose de l’ordre du dialogue ». On observe souvent une accumulation de différents matériaux dans une même œuvre qui donne des sens supplémentaires : « Au fond, [le choix du médium] doit avoir un lien avec ce que tu veux exprimer, que chaque élément ait un sens. C’est vraiment de cette façon-là que j’aborde la matière ».
La recherche comme fondement
Patricia Langevin se décrit comme une artiste de l’intuition et de la recherche-création, dont chaque œuvre est précédée d’un long travail de documentation, d’écoute, de traduction, de réflexion. L’artiste explique : « la partie recherche est plus importante que ce qui va sortir à la fin. Souvent, ce n’est pas complet tant que je n’ai pas réglé toutes les questions que j’avais en tête, ou que je ne suis pas allée chercher toutes les informations ». Elle se donne ainsi le droit de douter, d’explorer, d’apprendre. « C’est comme ça que je m’approprie la culture aussi. Aller poser des questions, voir ce qui a été fait. À chaque fois, c’est comme un nouvel univers », raconte-t-elle.
Héritages partagés
Avec sa filleule Raphaëlle Langevin, artiste et entrepreneure, la bachelière cosigne en 2023 Aianishkat / De génération en génération, une œuvre intergénérationnelle et multisensorielle dans laquelle les langues innue et française, les images d’archives, les gestes du quotidien et les rituels se tissent. Cette exposition était orientée vers les femmes, leur histoire, leur individualité. Patricia Langevin et sa filleule se sont mises à explorer ensemble le lien qui les unit, leur lignée, leur famille : « On a fait beaucoup de recherches et on a consulté les aîné·e·s de notre famille ». Ce projet, comme plusieurs autres, s’inscrit dans une volonté de sacralisation discrète : « les enseignements demeurent aujourd’hui quelque chose de privé, quelque chose d’intime. Un ami m’avait dit que chacun décide de ce qui, pour lui, a un caractère sacré. Mais pour moi, ces enseignements-là, c’est comme un bijou ou un élément précieux à conserver, à explorer, puis à traduire, sans donner toute l’information ».
Ce qui vient : des questions, encore
Toujours en mouvement, Patricia Langevin travaille actuellement sur trois projets : deux collaboratifs et un personnel. Le premier, O’ya’wih – qui signifie « cela goûte bon » – prendra la forme d’une exposition collective à Montréal, menée par l’artiste wendate Michèle St-Amand, avec six femmes autochtones de différents milieux qui explorent plusieurs médias. Le thème : les conséquences de la colonisation sur le corps et la sexualité des femmes autochtones. Le deuxième projet, Ka-matau Puhkutatau qui signifie « celles qui fabriquent de leurs mains », est issu d’un enseignement sur les raquettes de marche et d’une formation en intelligence artificielle suivie avec six femmes de sa communauté. Ensemble, elles forment un nouveau collectif artistique, qui présentera une installation lors d’une résidence à Recto-Verso en avril 2026, en collaboration avec le Département d’histoire de l’art de l’UQAM. Finalement, Patricia a obtenu une subvention pour faire une exposition sur la santé cardiaque chez les femmes autochtones. Le projet en verre soufflé, qui s’appelle temporairement Utei – c’est-à-dire « cœur » –, sera présenté en juin 2026 au Musée Ilnu de Mashteuiatsh.
À travers ses œuvres, Patricia Langevin porte une mémoire vive, où la résistance, l’héritage et la lumière tracent ensemble le chemin d’une parole qui se renouvelle.