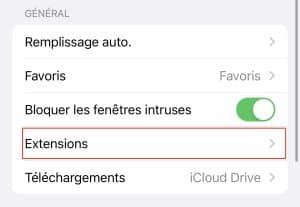Un texte de Charles Fontaine, collaborateur
Un texte de Charles Fontaine, collaborateur
La Bolivie, pays d’Amérique du Sud peuplé d’un peu moins de 12 millions d’habitants, vit aujourd’hui un basculement historique : après deux décennies marquées par des gouvernements de gauche, on assiste à l’effondrement de ce courant politique et à une recomposition complète du paysage démocratique à l’aube du second tour des élections présidentielles.
Une surprise au premier tour
Les résultats du premier tour du 17 août ont créé la surprise en redessinant le paysage politique bolivien. Alors que la gauche s’est effondrée, deux figures aux profils très différents s’affronteront désormais lors du second tour prévu pour le 19 octobre.
Le premier candidat qualifié pour le second tour est Rodrigo Paz. Son ascension a surpris bien des observateurs et observatrices et il reste difficile à situer sur l’échiquier politique. Paz oscille entre centre droit et droite libérale. Son programme repose sur des propositions telles que décentraliser le pouvoir en renforçant les régions, alléger la fiscalité tout en augmentant certains droits de douane, faciliter l’accès au crédit pour les populations et investir dans le développement d’énergies plus propres.
Le second candidat à s’être hissé au deuxième tour, Jorge Quiroga, représente la droite traditionnelle. Ancien collaborateur des grandes institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale, il prône une réduction de l’État et une relance de l’initiative privée. Son programme mise sur le retour des investisseurs étrangers pour dynamiser les industries d’exploitation, notamment celle du lithium, une ressource stratégique du pays.
Virage à droite
Chose certaine, ce premier tour de l’élection présidentielle a confirmé le virage à droite qui attend la Bolivie. Malgré leur style différent, Paz et Quiroga partagent plusieurs orientations communes : la fin des subventions aux carburants, une réduction de l’impôt et une rupture claire avec le modèle étatiste qui a marqué les dernières décennies. Ainsi, quelle que soit l’issue finale, le pays s’apprête à tourner une page importante de son histoire politique.
En effet, la gauche s’est effondrée lors de ce scrutin. S’il est encore trop tôt pour cerner toutes les causes de cette débâcle, certains facteurs sont déjà pointés du doigt. Selon le politologue Daniel Valverde, cité par l’AFP, l’inaction du gouvernement face à une crise marquée par une pénurie de devises étrangères et de carburant a « fini par fatiguer » une population déjà éprouvée par une inflation annuelle avoisinant les 25 %.
Notons également que le vote blanc a joué un rôle majeur lors du premier tour, atteignant près de 19 % des bulletins. Cette mobilisation fait suite à l’appel d’Evo Morales, interdit de se représenter par la Cour constitutionnelle, et a permis à de nombreux électeurs de gauche de manifester leur contestation tout en respectant l’obligation de voter.
À cela s’est ajoutée une lutte de pouvoir au sein du Mouvement vers le socialisme (MAS) qui a plongé le parti dans la division à l’approche des élections. Résultat : la gauche est sortie du premier tour avec seulement 3,1 % des voix pour le candidat du MAS, Eduardo del Castillo, et 8,2 % pour le président du Sénat, Andronico Rodriguez.
Quels effets sur la population bolivienne ?
Il est encore trop tôt pour le dire avec certitude, mais appliquer les coupes budgétaires promises dans un pays habitué depuis longtemps aux subventions et aux programmes sociaux s’annonce à la fois complexe et douloureux. La véritable difficulté pour les deux candidats sera de mettre en œuvre les réformes promises sans que la population ne subisse de plein fouet leurs conséquences, comme une répression accrue de la contestation sociale ou une accentuation des discriminations envers les populations indigènes.
S’il y a une lueur d’espoir à tirer de cette situation, c’est que l’état de la démocratie bolivienne s’est considérablement amélioré. Alors que le pays avait connu des coups d’État fréquents jusque dans les années 1980, il démontre aujourd’hui sa capacité à faire vivre un régime démocratique stable.