Au moment où Donald Trump fait un pas en arrière sur la mondialisation, en imposant des tarifs douaniers à ses partenaires commerciaux, il souffle en même temps sur les braises d’un nouvel impérialisme américain. De la conquête des marchés à la conquête des territoires, comment expliquer ce changement de la politique internationale américaine ? Quelles en sont les implications ?
Rappelons que la mondialisation de l’économie, qui repose sur la libéralisation des échanges commerciaux et financiers entre les pays, s’est intensifiée au tournant des années 1990, après la dislocation de l’Union soviétique et la chute des pays socialistes en Europe de l’Est. C’est à cette époque que les États-Unis ont joué un rôle important dans la création de l’Organisation mondiale du commerce, dans le but d’accélérer la mondialisation qui leur était alors favorable.
Le confusion trumpienne
Dès lors, les multinationales américaines ont déployé leurs chaînes de production à l’échelle planétaire, grâce à des filiales étrangères établies en fonction des avantages comparatifs que leur offraient les différentes régions du monde. C’est à partir de ce moment que les États-Unis ont importé davantage de produits, produits qui provenaient dans une large mesure des filiales américaines implantées à l’étranger.
C’est pourquoi l’accusation de Trump, selon laquelle les pays étrangers sont responsables de l’énorme déficit commercial des États-Unis, qu’il qualifie faussement de subventions à ces pays, ne tient pas la route. Les grand-es gagnant-es de la mondialisation sont les riches actionnaires de ces filiales américaines, à qui Trump offre de généreuses baisses d’impôt qu’il compte financer avec les tarifs douaniers que le peuple américain devra assumer.
Vers un cul-de-sac commercial
En fait, l’imposition de tarifs douaniers a peu de chances de rééquilibrer les échanges commerciaux des États-Unis avec le reste du monde, d’autant plus que les pays taxés répliquent avec des contre-tarifs. Pareille politique ne peut que conduire à un cul-de-sac commercial, car tous les pays ne pourront acheter les mêmes produits, ce qui fera ralentir l’économie mondiale.
En conséquence, il y aura des perdant-es qui feront d’autres perdant-es, et ainsi de suite, comme cela a été le cas lors de la grande crise des années 1930, qui a été précédée par d’importantes mesures protectionnistes aux États-Unis. Il est donc peu probable que cette politique mette fin à la désindustrialisation et aux pertes d’emplois aux États-Unis, lesquelles sont responsables de l’explosion des inégalités sociales et de l’affaiblissement de la classe moyenne américaine.
Le retour de l’impérialisme américain
Pour apaiser l’inquiétude des Américain-es qui voient leur niveau de vie reculer, Trump tente de créer une diversion en ressuscitant les velléités impérialistes des États-Unis. À défaut de faire croire aux Américain-es que l’industrie reviendra aux États-Unis, voilà que Trump propose de conquérir des territoires étrangers, dont le Canada, le Groenland et Panama. Est-ce sérieux ? Probablement moins dans le cas du Canada, son but étant d’arracher des gains importants lors de la renégociation de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique prévue en 2026, ou d’en retarder le renouvellement, voire de laisser mourir cet accord. Mais le niveau de risque est plus élevé pour le Groenland et Panama. D’où vient donc cette idée saugrenue de Trump ?
Trump s’inspire de deux anciens présidents américains pour qui la conquête de territoires fut un leitmotiv récurrent. Citons d’abord James K. Polk qui, lors de son mandat en 1845-1849, a doublé la superficie des États-Unis en absorbant le Texas et en annexant le tiers du territoire mexicain. Trump s’inspire aussi de William McKinley qui, pendant son mandat de 1897-1901, a imposé des tarifs douaniers de 50 % pour financer les dépenses publiques et protéger l’industrie américaine, et qui a négocié la construction du canal de Panama.
À part la courte période de l’histoire où les États-Unis ont implanté le New Deal (1933-1938), un programme d’aide aux Américain-es les plus démuni-es pendant la grande dépression des années 1930, l’impérialisme américain, avec ses visées expansionnistes, ont souvent refait surface dans les périodes de crise. Reste à savoir jusqu’où ira l’ivresse du pouvoir de l’empereur Trump.







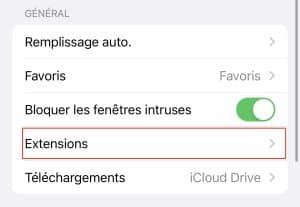

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Se connecter