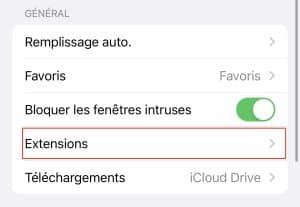Trois chefs de syndicat – Sonia Laliberté, présidente du Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs, Alexandra Vallières, présidente par intérim du Syndicat du personnel professionnel de l’éducation du Cœur et du Centre-du-Québec, et Stéphane Béland, président du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges – ont fait part de leurs inquiétudes quant à de récents projets de loi adoptés par le gouvernement Legault. Les trois syndicalistes soulignent que l’enjeu central reste le même, c’est-à-dire le manque de personnel dans les écoles ainsi que la difficulté d’attirer et de retenir les enseignant-es et les professionnel-les de l’éducation.
Selon les trois syndicalistes, la crise touchant le monde de l’éducation au Québec a des conséquences directes non seulement sur les conditions de travail, mais aussi sur la qualité des services offerts aux élèves, particulièrement les plus vulnérables. C’est dans ce contexte de fragilisation du milieu scolaire que les projets de loi 47, 89 et 100 prennent tout leur sens et suscitent des réactions partagées entre inquiétude et vigilance.
Projet de loi no 47
En septembre 2023, le Rapport d’enquête de portée générale sur la gestion administrative des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats révélait que « l’information ne chemine pas entre les différents employeurs » et que « la formation des intervenants est limitée ».
Dans ce contexte, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a présenté le projet de loi no 47, Loi visant à renforcer la protection des élèves concernant notamment les actes de violence à caractère sexuel. Adoptée à l’unanimité en avril 2024, cette loi oblige les centres de services scolaires et les établissements privés à se doter d’un code d’éthique applicable à tout le personnel. Elle impose aussi le signalement « sans délai au ministre de l’Éducation de toute situation concernant un enseignant et mettant en cause un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves ». Enfin, tout manquement restera désormais inscrit au dossier d’un-e employé-e.
Certaines personnes, dans le milieu, soulèvent des inquiétudes : « Bien sûr, ce qui importe le plus, c’est la sécurité et le bien-être des élèves […], mais quand on lit le projet de loi, on parle de délation entre collègues », explique Stéphane Béland. Sonia Laliberté ajoute que le code d’éthique, avec son « devoir de loyauté », limite la liberté d’expression des enseignant-es : « Ce code d’éthique est également très intrusif. Que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou des actions parallèles, comme à l’intérieur d’un parti politique. C’est donc vraiment alarmant. »
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse indique, dans une lettre envoyée à la Commission de la culture et de l’éducation, qu’elle accueille favorablement l’objectif mais considère que « les moyens proposés par le projet de loi […] apparaissent d’abord insuffisants pour assurer la protection des droits des élèves ». De leur côté, la Fédération des centres de services scolaires du Québec et l’Association des directions générales scolaires du Québec évoquent « certains défis d’application » et expriment des « préoccupations relatives au champ d’application de la loi » dans un mémoire également adressé à la Commission de la culture et de l’éducation.
Projet de loi no 89
Le projet de loi no 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, modifie le Code du travail pour assurer le maintien de « services assurant le bien-être de la population » en cas de conflit de travail, afin d’éviter qu’une grève ou un lock-out « affecte de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité ». Le gouvernement et le Tribunal administratif du travail peuvent « désigner, par décret, une association accréditée et un employeur » et « ordonner le maintien de tels services », avec possibilité de recours à l’arbitrage en cas de « préjudice grave ou irréparable ».
Pour Sonia Laliberté, ce projet introduit en éducation la notion de « services minimaux », ce qui « vient brimer et défaire tout ce rapport de force [entre les syndicats et le gouvernement] ». Elle juge cette notion « très subjective et très élastique », puisque les directions peuvent saisir le tribunal administratif du travail plus ou moins rapidement, selon leur volonté, pour tenter de limiter le droit de grève. « Tout cela vient changer le rapport de force, et c’est très grave, ça touche des droits fondamentaux. »
Pour Alexandra Vallières, ce projet de loi a des répercussions directes sur les élèves : « C’est quoi les leviers que nous, on va avoir pour faire reconnaître nos demandes ? Ce qu’on veut, en tant que syndicat de professionnel-les, c’est défendre des services de qualité […]. Comment défendre nos élèves les plus vulnérables si on ne peut plus négocier et qu’on se fait imposer des conditions de travail qui ne sont pas toujours aidantes ? »
Projet de loi no 100
Le projet de loi no 100, Loi sur la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale notamment dans les secteurs public et parapublic, vise à « encadrer la négociation et la détermination des conditions de travail requérant une coordination nationale », afin de « favoriser la cohérence et l’efficacité du processus » et de contrôler leurs effets sur les finances publiques. Il confie au président ou à la présidente du Conseil du trésor la responsabilité de développer une stratégie globale et de « négocier avec les associations accréditées pour le compte des employeurs ». Cette loi abolit la durée maximale des conventions collectives et abroge la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic.
Les changements suscitent toutefois des craintes importantes chez les deux syndicats de l’enseignement consultés, malgré que Sonia Laliberté estime qu’il y a « certains points positifs à ce projet de loi ». En fait, ils estiment que cette centralisation accrue pourrait réduire leur autonomie. Ils craignent que la recherche de « cohérence et d’efficacité » mène à une uniformisation ignorant les réalités régionales.
Auparavant, certains sujets pouvaient être exclus ou encadrés dans les moyens de pression. Dorénavant, les syndicats et les employeurs peuvent utiliser la grève ou le lock-out sur toutes les matières négociées. Ainsi, l’ouverture des grèves et lock-outs à l’ensemble des matières couvertes par une convention collective, combinée à l’abolition de la durée maximale de ces conventions, apparaît comme un élargissement des marges de négociation. Or, selon les syndicats de l’enseignement, ces dispositions pourraient surtout renforcer et la position du gouvernement, qui conserve le dernier mot sur les grandes orientations, malgré qu’en apparence, cela donne également plus de pouvoir aux syndicats.