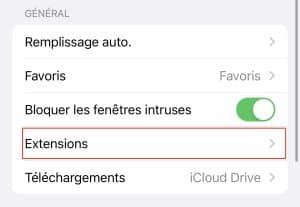Améliorer la qualité de l’eau, pour les poissons comme pour les humains : c’est la mission que s’est donnée le Secrétariat à l’aménagement et à la mise en valeur du bassin de la Batiscan et des affluents (SAMBBA) dans son projet S’unir et agir pour la rivière Champlain. Grâce à une approche collaborative et à un projet structurant dans le bassin versant de la rivière Champlain, elle agit concrètement pour protéger des espèces menacées et pour sensibiliser la population aux enjeux hydriques.
Un organisme au service de l’eau
Le SAMBBA est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans une perspective d’économie sociale depuis plus de 25 ans. Mandatée par le ministère de l’Environnement dans le cadre la loi sur l’eau, elle est chargée de coordonner la gestion intégrée de l’eau pour les bassins versants de la rivière Champlain, de la rivière Batiscan ainsi que de plusieurs plus petits cours d’eau dont les bassins sont dits « orphelins ».
Gabrielle Nobert-Hivon, biologiste et coordonnatrice de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, explique que « concrètement, quand on parle de gestion intégrée, c’est rassembler les gens qui utilisent l’eau du territoire. Et pour faire encore plus simple, c’est tout le monde. »
Le SAMBBA mobilise donc une diversité d’acteurs et d’actrices – citoyen-nes, agriculteur-trices, entreprises, municipalités, entre autres – à qui elle présente les constats issus des milieux humides et hydriques. Ensemble, ces personnes déterminent les actions prioritaires à mettre en œuvre en matière de gestion de l’eau, dans une perspective de développement durable. Ces actions sont ensuite regroupées dans un Plan directeur de l’eau pour les 10 années qui suivent.
Des poissons ayant des statuts en péril et préoccupants
Le SAMMBA désire également répondre aux problématiques du territoire en développant des projets subventionnés pour répondre aux besoins. C’est dans cette vision qu’a été créé le Projet de la rivière Champlain, un projet d’envergure qui s’échelonne sur quatre années et déployé sur l’ensemble du bassin versant de la rivière Champlain.
Gabrielle Nobert-Hivon explique que ce bassin versant fait face à des problèmes de « glissement de terrain, d’érosion, mais surtout, de mauvaise qualité de l’eau avec des problématique de turbidité et de matière en suspension dans la rivière ».
Pour situer le contexte, en 2016, un événement frappe le bassin versant de la rivière Champlain à la hauteur de Saint-Luc-de-Vincennes. Un glissement de terrain majeur survient et une masse d’argile bloque complètement le cours de la rivière. À la suite de cet évènement, le SAMBBA entreprend un projet pour délimiter une zone d’étude afin de déterminer si cette situation avait affecté le dard de sable, une espèce de poissons à statut précaire selon la Loi sur les espèces en périls.
Ce sont près de 67 dards de sables et 22 fouille-roches gris, une autre espèce de poisson ayant un statut d’espèce préoccupante selon la Loi sur les espèces en périls qui sont comptabilisés. « Ce sont des poissons qui ont besoin d’une bonne qualité d’eau, ils ont besoin d’une belle turbidité, c’est-à-dire une eau claire », explique Caroline Macarez, biologiste et chargée de projet pour le Projet rivière Champlain. Les deux biologistes racontent que ces espèces indigènes sont importantes, car elles se situent en bas de la chaîne alimentaire.

Source : SAMBBA
Le projet S’unir et agir pour la rivière Champlain
« C’est là qu’est née l’idée de mettre en place un projet global et structurant, qui nous permettrait d’agir concrètement sur plusieurs fronts », raconte Gabrielle Nobert-Hivon. En améliorant la qualité de l’eau, ce projet vise à redonner un second souffle aux écosystèmes aquatiques, en particulier aux populations de poissons qui dépendent d’habitats sains pour se reproduire et survivre. Mais les bienfaits ne s’arrêtent pas là : une eau plus propre, c’est aussi un atout essentiel pour la santé humaine.
Selon Caroline Macarez, plusieurs raisons expliquent la mauvaise qualité actuelle de l’eau. C’est par exemple la pollution provenant de l’agriculture, des industries et des villes qui entraîne une accumulation de dépôts dans les rivières. À cela s’ajoutent des obstacles qui bloquent l’écoulement naturel de l’eau, ainsi que les effets des changements climatiques qui modifient le débit des cours d’eau.
Pour atteindre ses objectifs, le projet s’articule autour de trois volets. Le premier consiste à développer un outil de priorisation, afin d’identifier les secteurs et les actions les plus pertinents pour protéger les habitats du dard de sable et du fouille-roches gris. Le deuxième volet prévoit la revitalisation de 5,5 hectares de bandes riveraines. Bien que ces plantations ne puissent prévenir les glissements de terrain en raison de l’instabilité du sol, elles agiront comme des filtres naturels, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l’eau. Enfin, le troisième volet vise à informer la population qui utilise l’eau et à la sensibiliser aux enjeux présents sur le territoire.